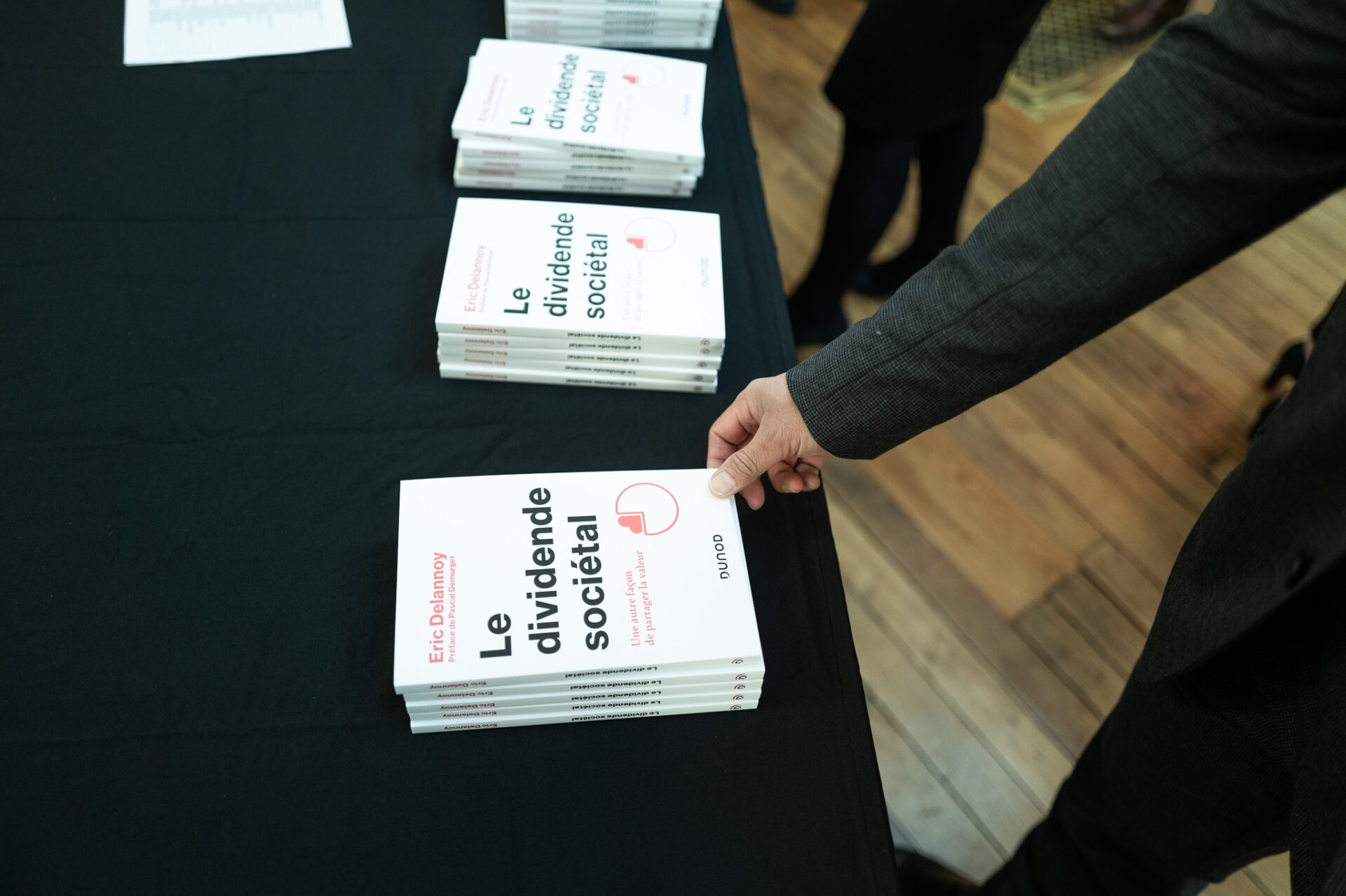Ce mercredi 2 avril s’est déroulé la 8ème cérémonie du Prix Tenzing de l’egalité des Chances salle Gaveau à Paris. Thierry Keller, co-fondateur du média Usbek & Rica, a animé les échanges qui réunissait quatre contributeurs du monde de l’entreprise et de la recherche, Gérald Bronner, sociologue, écrivain spécialiste des croyances collectives et de la désinformation ; Dominique Méda, Directrice du laboratoire Irisso de Paris-Dauphine et autrice du livre Une société désirable ; Virginie Leroy, Présidente de Vinci Immobilier et Thibaut Guilluy, Directeur Général de France Travail. Le thème de la soirée portait sur le travail à l’épreuve des transitions, sa rationalité, ses injonctions contradictoires et les enjeux de décision pour l’avenir.
L’intervention de Gérard Bronner a constitué la Key Note de la soirée. Le sociologue a ouvert le débat en interrogeant la notion de mérite. Le concept est associé à la notion de travail et aborde des problématiques à la fois liées à la justice et aux inégalités. Derrière ce thème se trouve le récit du déterminisme social dont le pouvoir performatif influence les ambitions et les résultats des personnes. Il révèle le côté « malléable » de l’identité, et représente un « effet Proteus » capable de la façonner en fonction du discours. Cet effet révèle une « souplesse identitaire » qui s’oppose à « l’habitus » hérité et qu’on ne peut changer. L’effet Proteus et les récits qui le portent sont certes « une fiction, mais une fiction utile »1. Cette fiction est « autoréalisatrice » et représente un outil à mobiliser afin de lutter contre le « fatalisme social » et mettre en capacité les personnes dans le cadre d’un monde professionnel plus juste. « Peut-être que nous abritons au coeur de nous-mêmes une société d’individus très différents et concurrents, qui vont s’activer en fonction des récits que nous allons faire de nous-même ».
Ce lien constitue une richesse et un atout qui rend un territoire attractif. Thibaut Guilluy prend l’exemple de Chalon-sur-Saône, un territoire caractérisé par la récente implantation de nombreuses entreprises du secteur secondaire, « ils en sont à la 6ème usine qui s’installe », précisément à cause de cette solidarité locale. Grâce à elle, « relocaliser devient un choix compétitif ». Mais le récit social possède aussi son rôle à jouer dans les enjeux de transition écologique et de réindustrialisation. La vocation de France Travail consiste à « redonner confiance en soi » aux populations fragilisées ; plus largement, elle doit contribuer à un « réenchantement du secteur industriel » déclarent son directeur général et Dominique Méda. Selon Eric Delannoy, La RSE « inscrit l’entreprise dans son environnement ». Avant tout, « la RSE produit du lien », entre entreprise et société, entre collaborateurs.
La reconversion écologique représente une grande opportunité mais produit également une forte déstabilisation. Selon la philosophe, elle ne doit pas se faire aux dépens des métiers qu’elle fragilise. Ces personnes auront besoin de formation et d’accompagnement pour une transformation réclamant en grande majorité des postes d’ouvriers. Thibaut Guilluy voit dans cet accompagnement la mission de France Travail qui doit « accompagner le succès et non simplement se limiter à répondre au chômage ».
Pourtant, la RSE est critiquée depuis ces derniers mois à l’échelle internationale. Alors qu’il y a un an, elle avait le vent en poupe, le succès de l’extrême droite aux élections européennes, la remise en cause de la CSRD et l’élection de Donald Trump ont retourné la situation, provoquant une forte demande politique du retour au « business as usual » aux dépens des politiques RSE. Dominique Méda affirme que, en réaction, le monde a besoin de ce modèle d’entreprise socialement et écologiquement responsable porté par une Europe plus « résolue », plus cohérente dans ses choix et plus « centralisée » ; plaidant pour une réponse en partie politique à cet enjeu social et économique : « les États-Unis d’Europe ». Thibaut Guilluy remarque cependant les problèmes de conception trop bureaucratiques et les récurrentes difficultés d’exécution qui en découlent ; des problèmes qui réduisent l’efficacité des régulations européennes. Il rappelle que le récit porté par la RSE ne peut s’affranchir des réalités économiques.
La table ronde s’est conclue sur le rôle de l’entreprise. Les intervenants abondent sur l’importance de la coopération entre elle et l’État. Selon Dominique Méda, il n’est pas question de remplacer l’un par l’autre, mais l’État doit concentrer ses efforts de soutien sur les acteurs vertueux qui œuvrent dans le sens d’un futur désirable. Pour Virginie Leroy, le rôle bénéfique des entreprises et la notion même de rentabilité sont intimement liés, puisque « les engagements RSE sont au cœur du business ».
Les prix Tenzing ont ensuite été remis aux associations lauréates :
- ADEPAPE 13, qui porte la voix des jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et les accompagne dans leurs premiers pas vers l’autonomie
- Pas à Pas, l’Enfant, qui agit pour réduire l’exposition des jeunes enfants aux écrans, en favorisant les interactions humaines, le jeu et la lecture, essentiels à leur développement
- La Fédération Les Ecoles de Production , qui regroupe des établissements formant des jeunes aux métiers manuels d’excellence, en réponse aux enjeux de réindustrialisation et à la nécessité de valoriser une nouvelle génération de professionnels qualifiés

Le prix représente pour ces associations une enveloppe de 170 000€, un financement récurrent de 20 000€ annuel pendant 3 ans et un mécénat de compétences pour leurs besoins de professionnalisation et de développement.
Eric Delannoy, président de Tenzing, a conclu la soirée en intervenant sur le dividende sociétal, le sujet de son livre qui sera publié le 9 avril. Pour lui, le dividende sociétal doit être considéré comme un choix stratégique. Il offre une pérennité au modèle d’entreprise en subvertissant les termes du récit du capitalisme et en « inscrivant la structure dans son environnement », « c’est une mise en lien » affirme-t-il.
Cependant, la difficulté reste de convaincre les actionnaires de consacrer « une infime part des bénéfices », de l’ordre de 5%, à une telle mesure. En limitant volontairement son ambition à 5% qui malgré tout permettrait de dégager des milliards d’euros chaque année, le dividende sociétal ne changerait en rien la vie des actionnaires, alors qu’il permettrait de mobiliser des moyens considérables pour se confronter aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels l’État seul ne peut pas faire face.
Pour convaincre, il faut compter sur un comportement de « mimétisme » en valorisant les histoires à succès des acteurs qui l’ont mis en place, particulièrement celles des pays nordiques. On retient le cas de Novo Nordisk, une entreprise pharmaceutique danoise qui a décidé de créer une fondation actionnaire pour le bien vivre et le bien vieillir, à but non lucratif, dotée d’un budget de 150 milliards d’euros.
Les entreprises doivent voir dans l’État « un moyen de démultiplier leur action » en faveur de la société. Ce dernier a aussi un rôle à jouer grâce, par exemple, à des incitations fiscales.
Le dividende sociétal est donc un moyen de « changer les imaginaires et lutter contre le fatalisme », mais pour cela « l’entreprise doit se décentrer de son seul intérêt propre pour consacrer une partie de sa dynamique et de ses moyens à l’intérêt général ».